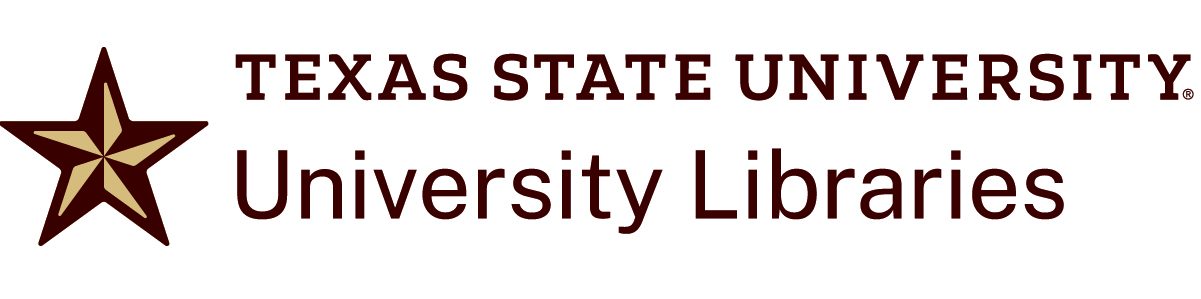19 2 – 4
SECONDE PARTIE
C’était une ancienne tradition passée de l’Egypte en Grèce, qu’un dieu ennemi du repos des hommes était l’inventeur des sciences.
Quelle opinion fallait-il donc qu’eussent d’elles les Egyptiens mêmes, chez qui elles étaient nées? C’est qu’ils voyaient de près les sources qui les avaient produites.
En effet, soit qu’on feuillette les annales du monde, soit qu’on supplée à des chroniques incertaines par des recherches philosophiques, on ne trouvera pas aux connaissances humaines une origine qui réponde à l’idée qu’on aime à s’en former.
L’astronomie est née de la superstition; l’éloquence, de l’ambition, de la haine, de la flatterie, du mensonge; la géométrie, de l’avarice; la physique, d’une vaine curiosité; toutes, et la morale même, de I’orgueil humain.
Les sciences et les arts doivent donc leur naissance à nos vices: nous serions moins en doute sur leurs avantages, s’ils la devaient à nos vertus.
Le défaut de leur origine ne nous est que trop retracé dans leurs objets.
Que ferions-nous des arts, sans le luxe qui les nourrit? Sans les injustices des hommes, à quoi servirait la jurisprudence? Que deviendrait l’histoire, s’il n’y avait ni tyrans, ni guerres, ni conspirateurs? Qui voudrait, en un mot, passer sa vie à de stériles contemplations, si chacun, ne consultant que les devoirs de l’homme et les besoins de la nature, n’avait de temps que pour la patrie, pour les malheureux et pour ses amis? Sommes-nous donc faits pour mourir attachés sur les bords du puits où la vérité s’est retirée? Cette seule réflexion devrait rebuter, dès les premiers pas, tout homme qui chercherait sérieusement à s’instruire par l’étude de la philosophie.
Que de dangers, que de fausses routes dans l’investigation des sciences! Par combien d’erreurs, mille fois plus dangereuses que la vérité n’est utile, ne faut-il point passer pour arriver à elle! Le désavantage est visible: car le faux est susceptible d’une infinité de combinaisons; mais la vérité n’a qu’une manière d’être.
Qui est-ce d’ailleurs qui la cherche bien sincèrement? Même avec la meilleure volonté, à quelles marques est-on sûr de la reconnaître? Dans cette foule de sentiments différents, quel sera notre criterium pour en bien juger? Et ce qui est le plus difficile, si, par bonheur, nous le trouvons à la fin, qui de nous en saura faire un bon usage? Si nos sciences sont vaines dans l’objet qu’elles se proposent, elles sont encore plus dangereuses par les effets qu’elles produisent.
Nées dans l’oisiveté, elles la nourrissent à leur tour; et la perte irréparable du temps est le premier préjudice qu’elles causent nécessairement à la société.
En politique comme en morale, c’est un grand mal que de ne point faire de bien; et tout citoyen inutile peut être regardé comme un homme pernicieux.
Répondez-moi donc, philosophes illustres, vous par qui nous savons en quelles raisons les corps s’attirent dans le vide; quels sont, dans les révolutions des planètes, les rapports des aires parcourues en temps égaux; quelles courbes ont des points conjugués, des points d’inflexion et de rebroussement; comment l’homme voit tout en Dieu; comment l’âme et le corps se correspondent sans communication, ainsi que feraient deux horloges; quels astres peuvent être habités; quels insectes se reproduisent d’une manière extraordinaire: répondez-moi, dis-je, vous de qui nous avons reçu tant de sublimes connaissances: quand vous ne nous auriez jamais rien appris de ces choses, en serions-nous moins nombreux, moins bien gouvernés, moins redoutables, moins florissants, on plus pervers? Revenez donc sur l’importance de vos productions; et si les travaux des plus éclairés de nos savants et de nos meilleurs citoyens nous procurent si peu d’utilité, dites-nous ce que nous devons penser de cette foule d’écrivains obscurs et de lettrés oisifs qui dévorent en pure perte la substance de l’état.
Que dis-je, oisifs? et plût à Dieu qu’ils le fussent en effet! Les moeurs en seraient plus saines et la société plus paisible.
Mais ces vains et futiles déclamateurs vont de tous côtés, armés de leurs funestes paradoxes, sapant les fondements de la foi et anéantissant la vertu.
Ils sourient dédaigneusement à ces vieux mots de patrie et de religion, et consacrent leurs talents et leur philosophie à détruire et avilir tout ce qu’il y a de sacré parmi les hommes.
Non qu’au fond ils haïssent ni la vertu ni nos dogmes; c’est de l’opinion publique qu’ils sont ennemis; et, pour les ramener au pied des autels, il suffirait de les reléguer parmi les athées.
O fureur de se distinguer, que ne pouvez-vous point! C’est un grand mal que l’abus du temps.
D’autres maux pires encore suivent les lettres et les arts.
Tel est le luxe, né comme eux de I’oisiveté et de la vanité des hommes.
Le luxe va rarement sans les sciences et les arts, et jamais ils ne vont sans lui.
Je sais que notre philosophie, toujours féconde en maximes singulières, prétend, contre I’expérience de tous les siècles, que le luxe fait la splendeur des Etats; mais, après avoir oublié la nécessité des lois somptuaires, osera-t-elle nier encore que les bonnes moeurs ne soient essentielles à la durée des empires, et que le luxe ne soit diamétralement opposé aux bonnes moeurs? Que le luxe soit un signe certain des richesses; qu’il serve même si l’on veut à les multiplier: que faudra-t-il conclure de ce paradoxe si digne d’être né de nos jours? et que deviendra la vertu, quand il faudra s’enrichir à quelque prix que ce soit? Les anciens politiques parlaient sans cesse de moeurs et de vertu: les nôtres ne parlent que de commerce et d’argent.
L’un vous dira qu’un homme vaut, en telle contrée, la somme qu’on le vendrait à Alger; un autre, en suivant ce calcul, trouvera des pays où un homme ne vaut rien, et d’autres où il vaut moins que rien.
Ils évaluent les hommes comme des troupeaux de bétail.
Selon eux, un homme ne vaut à l’Etat que la consommation qu’il y fait …