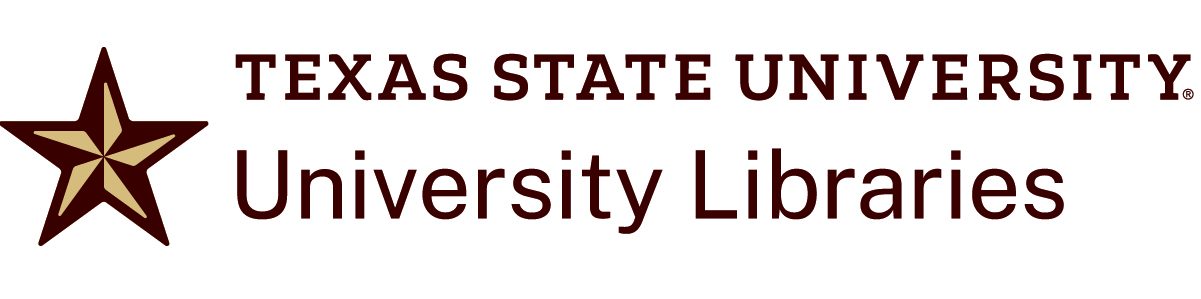17 2 – 2
L’esprit a ses besoins, ainsi que le corps.
Ceux-ci sont les fondements de la société, les autres en sont l’agrément.
Tandis que le gouvernement et les lois pourvoient à la sûreté et au bien-être des hommes assemblés, les sciences, les lettres et les arts, moins despotiques et plus puissants peut-être, étendent des guirlandes de fleurs sur les chaînes de fer dont ils sont chargés, étouffent en eux le sentiment de cette liberté originelle pour laquelle ils semblaient être nés, leur font aimer leur esclavage, et en forment ce qu’on appelle des peuples policés.
Le besoin éleva les trônes, les sciences et les arts les ont affermis.
Puissances de la terre, aimez les talents, et protégez ceux qui les cultivent [1].
Peuples policés, cultivez-les : heureux esclaves, vous leur devez ce goût délicat et fin dont vous vous piquez; cette douceur de caractère et cette urbanité de moeurs qui rendent parmi vous le commerce si liant et si facile; en un mot, les apparences de toutes les vertus sans en avoir aucune.
C’est par cette sorte de politesse, d’autant plus aimable qu’elle affecte moins de se montrer, que se distinguèrent autrefois Athènes et Rome dans les jours si vantés de leur magnificence et de leur éclat, c’est par elle, sans doute, que notre siècle et notre nation l’emporteront sur tous les temps et sur tous les peuples.
Un ton philosophe sans pédanterie, des manières naturelles et pourtant prévenantes, également éloignées de la rusticité tudesque et de la pantomime ultramontaine: voilà les fruits du goût acquis par de bonnes études et perfectionné dans le commerce du monde.
Qu’il serait doux de vivre parmi nous, si la contenance extérieure était toujours l’image des dispositions du coeur, si la décence était la vertu, si nos maximes nous servaient de règle, si la véritable philosophie était inséparable du titre de philosophe! Mais tant de qualités vont trop rarement ensemble, et la vertu ne marche guère en si grande pompe.
La richesse de la parure peut annoncer un homme opulent, et son élégance un homme de goût: l’homme sain et robuste se reconnaît à d’autres marques; c’est sous l’habit rustique d’un laboureur, et non sous la dorure d’un courtisan, qu’on trouvera la force et la vigueur du corps.
La parure n’est pas moins étrangère à la vertu, qui est la force et la vigueur de l’âme.
L’homme de bien est un athlète qui se plaît à combattre nu; il méprise tous ces vils ornements qui gêneraient l’usage de ses forces, et dont la plupart n’ont été inventés que pour cacher quelque difformité.
Avant que l’art eût façonné nos manières et appris à nos passions à parler un langage apprêté, nos moeurs étaient rustiques, mais naturelles; et la différence des procédés annonçait au premier coup d’oeil, celle des caractères.
La nature humaine, au fond, n’était pas meilleure: mais les hommes trouvaient leur sécurité dans la facilité de se pénétrer réciproquement; et cet avantage, dont nous ne sentons plus le prix, leur épargnait bien des vices.
Aujourd’hui que des recherches plus subtiles et un goût plus fin ont réduit l’art de plaire en principes, il règne dans nos moeurs une vile et trompeuse uniformité, et tous les esprits semblent avoir été jetés dans un même moule: sans cesse la politesse exige, la bienséance ordonne; sans cesse on suit des usages, jamais son propre génie.
On n’ose plus paraître ce qu’on est; et, dans cette contrainte perpétuelle, les hommes qui forment ce troupeau qu’on appelle société, placés dans les mêmes circonstances, feront tous les mêmes choses si des motifs plus puissants ne les en détournent.
On ne saura donc jamais bien à qui l’on a affaire: il faudra donc, pour connaître son ami, attendre les grandes occasions, c’est-à-dire attendre qu’il n’en soit plus temps, puisque c’est pour ces occasions mêmes qu’il eût été essentiel de le connaître.
Quel cortège de vices n’accompagnera point cette incertitude! plus d’amitié sincère; plus d’estime réelle; plus de confiance fondée.
Les soupçons, les ombrages, les craintes, la froideur, la réserve, la haine, la trahison se cacheront sans cesse sous ce voile uniforme et perfide de politesse, sous cette urbanité si vantée que nous devons aux lumières de notre siècle.
On ne profanera plus par des jurements le nom du Maître de l’univers; mais on l’insultera par des blasphèmes, sans que nos oreilles scrupuleuses en soient offensées.
On ne vantera pas son propre mérite, mais on rabaissera celui d’autrui.
On n’outragera point grossièrement son ennemi, mais on le calomniera avec adresse.
Les haines nationales s’éteindront, mais ce sera avec l’amour de la patrie.
A l’ignorance méprisée on substituera un dangereux pyrrhonisme.
II y aura des excès proscrits, des vices déshonorés; mais d’autres seront décorés du nom de vertus; il faudra ou les avoir ou les affecter.
Vantera qui voudra la sobriété des sages du temps; je n’y vois, pour moi, qu’un raffinement d’intempérance autant indigne de mon éloge que leur artificieuse simplicité [2].
[1] Les princes voient toujours avec plaisir le goût des arts agréables et des superfluités dont l’exportation de l’argent ne résulte pas s’étendre parmi leurs sujets. Car outre qu’ils les nourrissent ainsi dans cette petitesse d’âme si propre à la servitude, ils savent très bien que tous les besoins que le peuple se donne sont autant de chaînes dont il se charge.
[2] J’aime dit Montaigne, à contester et discourir, mais c’est avecques peu d’hommes, et pour moy. Car de servir de spectacle aux grands, et faire à l’envy parade de son esprit et de son caquet, je treuve que c’est un mestier tres messéant à un homme d’honneur. C’est celui de tous nos beaux esprits, hors un, ajoute Rousseau en pensant à son ami, le philosophe, Denis Diderot.